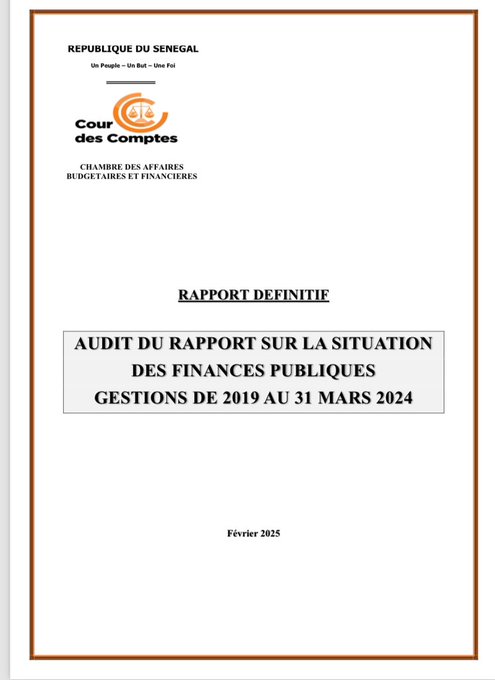
Le jadis très attendu Rapport de la Cour des comptes, est dorénavant tant contesté. Comme on pouvait s’y attendre, le contenu dudit Rapport divise les acteurs politiques selon qu’il est lu avec les lunettes du dirigeant actuel ou par celles de l’opposant. Pour les uns. il reflète la situation financière du pays alors que pour les autres il s’agit simplement d’un document taillé sur mesure pour incriminer des dignitaires de l’ancien régime.
Faisant abstraction des allégations de détournements dont il revient à la justice d’en donner des suites, cette analyse propose un diagnostic macroéconomique du contexte qui confirme la Cour. Ainsi, deux indicateurs clés nous intéressent ici, le déficit et la dette publics. D’emblée rappelons qu’un déficit survient lorsque les recettes publiques (fiscales, dons,...) sont dépassées par les dépenses de l’Etat. Cette situation qui est le cas le plus fréquent pour les pays en développement comme le nôtre, oblige l’Etat à s’endetter pour assurer son financement. D’où le co-mouvement, soit de hausse soit de baisse des rapports déficit sur Pib et Dette sur Pib, selon les situations.
Ainsi, une analyse du contexte macroéconomique de la période passée en revue par le Rapport, de 2019 à 2024, permet d’identifier au moins Trois (3) faits économiques majeurs, qui corroborent les niveaux de déficit et de dette publics plus élevés que ceux annoncés ultérieurement par le régime sortant. Ces derniers, constituent des chocs ayant participé à creuser les déficits publics et par ricochet à alourdir le fardeau de la dette contractée pour les financer.
Les premiers cas de Covid ont été enregistrés au Sénégal au début de l’année 2020. Très vite le virus se propage. Entre restrictions des déplacements, puis couvre-feu et enfin confinement l’activité économique tourne au ralenti. Tous les secteurs d’activités ou presque ressentent durement la crise. Le Taux de croissance du Pib réel du Sénégal s’est ainsi établi à 1.9% en 2020 contre 4.4% en 2019. Soit une baisse de plus de 2%.
Logiquement, les recettes fiscales baissent à leur tour d’environ 0.2%. Cette baisse est liée au ralentissement économique noté. Les fermetures d’entreprises, la baisse des volumes des échanges internationaux suite aux restrictions entre pays et les mesures de gel des exportations de certains pays producteurs ou encore l’arrêt des activités touristiques sont autant de facteurs qui entament les recettes publiques. Du point de vue des dépenses, la lutte contre la pandémie nécessite une augmentation des de celles du secteur de la santé. A cela s’ajoutent les aides aux ménages vulnérables et les engagements spéciaux de soutien à l’économie.
Ainsi, dans ce contexte de hausse des dépenses et de baisse des recettes, c’est tout naturellement que le déficit public se creuse. Il s’est alors situé à 6.1% du Pib en 2020 et 6.3% en 2021, selon les données communiquées par le gouvernement à l’époque. En comparaison, la Côte d’Ivoire et le Rwanda, enregistraient respectivement des déficits de 2.3% et 7.4% en 2019, c’est à dire avant la crise sanitaire. Selon les données de la BAD, ces deux pays ont enregistré des déficits publics de 5% et 8.5% en 2021. Ainsi tout comme le Sénégal qui est passé de 3.9% de déficit de la situation d’avant Covid à 6.3%, ces deux grandes economies africaines beaucoup plus résilientes que la nôtre ont été durement touchées par la crise.
La crise Russo-Ukrainienne est également un facteur de dégradation des conditions économiques des pays importateurs nets de produits alimentaires. Elle a entrainé un renchérissement des prix des matières premières comme le pétrole, le blé et les engrais. Celles-ci étant importées par notre pays, il en découle une hausse des importations en valeur et la dégradation de la balance commerciale. Par conséquent, le déficit public se creuse. Pour atténuer l’effet des chocs, l’Etat accroît les subventions via une dette supplémentaire. Une mesure salutaire sur le plan social, pour éviter des émeutes de la faim telles que le pays en a connues auparavant, mais qui dégrade les finances publiques.
Toujours selon les données officielles, le déficit du Sénégal s’est situé à 6.5% en 2022 contre 6.3% en 2021 soit une hausse très modérée de de 0.2%. Là où pour la Côte d’Ivoire il est passé de 5% en 2021 à 6.8% en 2022 soit une hausse de 1.8%. De même pour le Rwanda malgré une baisse par rapport à 2021, il est tout de même chiffré à 7.6% du Pib.
La période 2021-2024 a été marquée par des mouvements de contestation populaires qui ont eu pour effets directs, la perturbation voire l’arrêt par moments de l’activité économique. Les entreprises ont été contraintes à plusieurs reprises d’observer un arrêt de travail. De même les activités commerciales ont chuté drastiquement. L’incertitude politique et la dégradation du climat des affaires ont eu pour conséquence la méfiance des investisseurs à l’égard du pays. Au même moment, le régime en place contre toute logique intuitive, entreprend des actions économiques au relent politique très fort. C’est le cas du programme « Kheuyou Ndaw Yi », vaste opération de recrutement des jeunes désœuvrés à qui l’ancien président, au soir de cinglantes manifestations lançait « Je vous ai compris ». Le financement de ce programme ainsi que des plans sociaux improvisés, ne pouvait qu’accentuer un déficit public déjà très important. Étant donné la baisse logique et irréversible es recettes fiscales pendant cette période d’instabilité, l’endettement était l’unique option de financement des programmes entrepris par les autorités.
Contre toute logique économique, avec les effets cumulés de ces trois crises, le déficit budgétaire était annoncé en légère baisse dans la LFI de 2023 pour se situer à 5.5% contre 6.8% en 2022. Il devait même se rapprocher de la norme de l’Uemoa en 2024 en s’élevant à 3.9% soit le niveau d’avant Covid 19. Sachant que les deux autres pays ne sont pas concernés par la troisième crise, il est surprenant que le déficit de la Côte d’Ivoire se situe relativement au même niveau que celui du Sénégal, à 5.3% du Pib et à 7.1% pour le Rwanda en 2023. Le décalage entre le cadre macroéconomique et l’évolution du déficit du Sénégal sur cette période est flagrant. La comparaison avec la Côte d’Ivoire et le Rwanda, qui sont un cran au-dessus de l’économie sénégalaise permet d’y voir plus clair et de corroborer les conclusions de la Cours sur la « déflation » des niveaux de déficit et de dette du Sénégal.
Dr Amadou Woury Diallo
Economiste.
amadouwourydiallo@gmail.com.


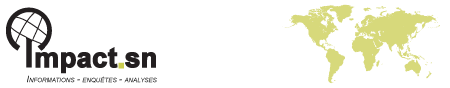
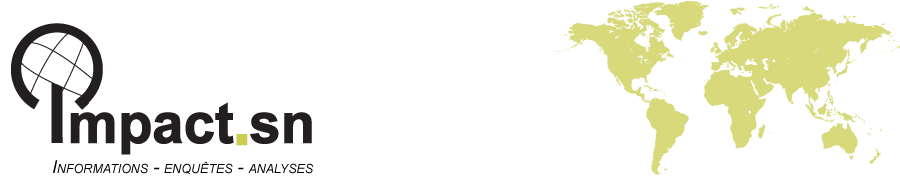
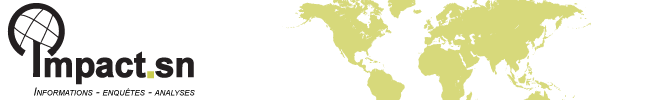





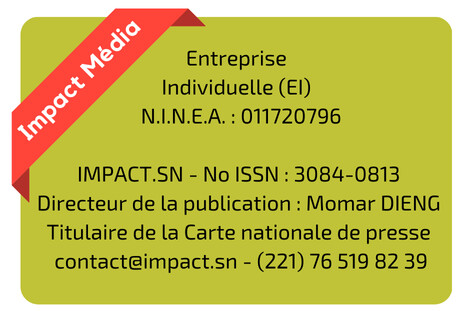





 FRANCE
FRANCE















