
Peut-on réussir des projets de développement à caractère économique dans la partie de l’Afrique contemporaine logée au sud du Sahara, cette Afrique qui, par la faveur du partage issu de la conférence de Berlin (1884/1885), a été baptisée pendant la période coloniale, Afrique Française ?
Permettez que je doute fort de la possibilité d’une réponse positive. La raison de ce doute n’est certainement pas dans une quelconque incurie des différents gouvernants auxquels nous avons successivement confiés nos destinées. Sans les dédouaner totalement, je crois que par le biais d’analyses hâtives et superficielles, nous avons pris l’habitude de les vouer aux gémonies.Mais pour cette fois, la raison de mon doute se situe bien ailleurs. Elle me parait même structurelle voire consubstantielle à la création de nos Etats. Au regard des difficultés de nos pays à décoller vers le développement, on a l’impression de vivre un éternel recommencement tel Sisyphe et son légendaire rocher.
Aller au-delà des analyses superficielles passe par une mise en examende ma propre science, le droit, pour voir s’il ne fait pas partie des coupables du retard économique depuis notre indépendance politique.
Concernant le Sénégal, après la gouvernance économique de Senghor, de Diouf et de Wade, nous vivons actuellement le PSE, un projet économique pour un programme politique ambitieux du parti de Sall actuellement au pouvoir… Je lui souhaite de réussir pour notre bien à tous !
Parmi les instruments ou les outils indispensables à cette réussite figure le DROIT. La question qui mérite donc d’être posée à ce niveau et que je pose ici, est celle de savoir si notre droit actuel, notre droit positif, assume le rôle de facilitateur de l’économie qu’on prétend lui faire jouer depuis la prise de conscience par la quasi-totalité des observateurs et acteurs du jeu économique africain de la nécessité d’un « droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté afin de faciliter l’activité des entreprises » pour paraphraser le Préambule du Traité pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Aujourd’hui, cette prise de conscience doit avoir comme objectif spécifique, la construction des fondements d’un véritable écosystème de la croissance et de l’innovation qui devra se traduire par un environnement juridique repensé.
Mais, avons-nous ici et maintenant, au Sénégal, un droit qui serait un outil au service d’une économie prête à affronter les défis du PSE, un droit pour la révolution numérique et ses innovations, un droit pour les exigences du monde rural d’aujourd’hui, un droit pour les enjeux technologiques de demain comme les bio et les nanotechnologies ou les neurosciences ?
Pour répondre, il faut sortir des sentiers battus comme je viens de le dire ci-dessus (je vais me répéter mais on dit que la répétition est pédagogique). Oui, les comportements des acteurs de la vie politique n’expliquent pas entièrement pourquoi nous sommes à la traîne dans les divers classements et autres modes d’évaluation des économies contemporaines. Permettez donc que je balaie devant ma propre porte. Que j’interroge ma discipline pour montrer comment elle impacte négativement sur notre économie, comment elle est au cœur de notre position économique actuelle et enfin, pourquoi il faudrait changer de paradigme dans le monde du droit pour en faire un véritable facilitateur de l’économie.
Oui. Il faut en effet savoir que le droit n’est pas une discipline abstraite ou désincarnée, mais plutôt le reflet d’un état d’esprit, d’une culture et de grands choix collectifs. Or le droit qui nous régit est frappé d’une tare originelle. C’est un droit emprunté, un droit venant essentiellement du droit français qui a certes fait école dans le monde à l’époque napoléonienne, mais dont les français eux-mêmes disent « qu’il tient du chef d’œuvre en péril : vieilli, anachronique, en déphasage complet avec le monde agile d’aujourd’hui. Pis, il condamne l’innovation, ce carburant d’une période de mutations intenses ». (Vincent Giret, Le droit, les rentiers ou l’innovation, Le Monde du 11 Mars 2016, p. 7)…Trois exemples pour illustrer ces propos…
Quel droit pour le numérique ?
En me limitant au mobile, on peut dire qu’on assiste aujourd’hui à une sorte d’inversion de paradigme dans les pratiques sociales incluant la technologie de pointe qu’est le téléphone portable. Des opérateurs innovants se sont engouffrés dans cette niche que constitue le marché des services financiers hors des guichets et des établissements bancaire proprement dits.Pour réglementer, la prise en compte de l’aspect convergence entre le droit bancaire et le droit des communications électroniques est une nécessité. Mais il y a une difficulté. Elle tient au fait que l’innovation ne provenant pas du tout des pays développés (ce sont les populations des pays en développement qui, par la pratique, imaginent des outils de contournement des difficultés d’accès aux services financiers relevant du monopole bancaire), on a du mal à implémenter une réglementation efficace. Oui, autant les pays développés fournissent généralement les modèles de réglementation pour les pays de l’ouest africain de tradition francophone par le biais de ces greffes que constituent les « legal transplants » ayant pour objet le transport du droit ou de règles d’un pays dans un autre, autant aujourd’hui, il y a lieu de faire jouer l’imagination car beaucoup de ces innovations n’entrent pas dans les casiers connus du droit positif.
Quel droit pour le monde rural ?
Le monde rural est la grande oubliée de l’OHADA. L’entreprise agricole, n’est toujours pas dotée de la structure juridique adéquate. En effet, dans un pays comme le Sénégal, malgré les nombreuses tentatives depuis les coopératives paysannes du temps du Président Senghor, jusqu’au groupement d’intérêt économique des années 80 sous le Président Abdou Diouf, en passant par les sociétés unipersonnelles ou plus récemment le statut de l’entreprenant du système OHADA, le monde rural n’arrive pas à trouver la structure idoine qui va le conduire aux formes d’exploitation économique qu’exige le monde contemporain.
Quel droit pour l’investissement dans les projets d’infrastructures ?
Toutes les formes d’investissements ne sont pas prises en compte dans le code des investissements. Notre code connait très bien l’investisseur économique traditionnel mais il ne s’est pas adapté aux mutations qui ont fait apparaître aussi bien l’investisseur professionnel, que l’investisseur dans les projets d’infrastructures. Le code des investissements est dépassé : l’investisseur du code existe toujours mais il s’installe dans des endroits très « compétitifs » comme les pays à régime autoritaire ou les pays à « faible intensité juridique » (très peu de protection pour les travailleurs et très peu de taxes et impôts).
L’investisseur professionnel, lui, est un investisseur au sens du droit des sociétés, c’est-à-dire concrètement, un actionnaire qui investit dans une grande société. Toutefois, ce n’est pas n’importe quel actionnaire, ni n’importe quel investisseur. On parle ici du gestionnaire de l’épargne collective ou fonds souverain appartenant à un Etat (gestionnaire de fonds de pension ou de fonds souverains étatiques). L’investisseur professionnel investit donc à la place de ses mandants (adhérents ou Etat) et pour leur compte, en prenant une participation minoritaire dans le capital de sociétés d’accueil.
L’arrivée de cet investisseur change absolument tout. Si on considère être en face d’un simple fournisseur de biens et services à l’administration, le droit des marchés publics aura vocation à s’appliquer. Mais s’il s’agit d’un investisseur qui vient « risquer ses billes », est-il toujours approprié de le mettre dans la procédure de la commande publique ? A mon avis, il y a quand même lieu de noter la différence entre une commande de l’administration et une proposition émanant d’un investisseur privé. Une inversion de ces données n’autorise-t-elle pas une autre structuration des relations Etat/secteur privé ?
En tout état de cause et quelle que soit la réponse, des mesures doivent être prévues dans le sens de la sauvegarde de notre souveraineté économique via nos entreprises locales. Une révision du code des investissements pourrait être envisagée pour déboucher sur une loi d’orientation de l’investissement au Sénégal avec comme objectif principal l’insertion du privé national dans notre tissu économique.
Pour conclure.
Ces trois exemples montrent que notre droit peine à faciliter la vie à l’activité économique.Les raisons sont à chercher dans le fait que le Nobel d’économie de 1993 Douglas North, appelle les « institutions », c’est-à-dire l’ensemble des lois, des règles écrites ou informelles ainsi que les instruments créés pour en contrôler leur bonne application, ces institutions donc ne sont pas en phase avec les besoins d’une économie dans la voie de l’émergence. Nous essayons de rattraper le retard avec les outils juridiques d’un autre âge. Oui, notre droit est resté statique et nous les juristes on continue à construire ce droit de manière autonome et abstraite en multipliant les typologies et les qualifications juridiques déconnectées des réalités économiques. C’est peut-être agréable et cohérent en soi, mais nos constructions sont davantage conçues pour les livres que pour la vie réelle. Au lieu de voir le droit comme un moyen, un outil, les juristes ont tendance à sacraliser le droit comme une valeur elle-même, comme une science qui se suffit à elle-même au lieu d’y voir un moyen par lequel divers acteurs peuvent réaliser des objectifs (Un droit pour l’innovation et la croissance, Vermeille, Kohmann et Luinaud, Fondation pour l’innovation politique, Paris, Février 2016).
Finalement, s’il n’est pas le seul coupable, on peut considérer que le droit pourrait être cité parmi les complices de notre indigence économique. En conséquence, il nous faut un autre droit pour accompagner notre développement économique…
Professeur Abdoulaye SAKHO
Institut EDGE/CRES
Permettez que je doute fort de la possibilité d’une réponse positive. La raison de ce doute n’est certainement pas dans une quelconque incurie des différents gouvernants auxquels nous avons successivement confiés nos destinées. Sans les dédouaner totalement, je crois que par le biais d’analyses hâtives et superficielles, nous avons pris l’habitude de les vouer aux gémonies.Mais pour cette fois, la raison de mon doute se situe bien ailleurs. Elle me parait même structurelle voire consubstantielle à la création de nos Etats. Au regard des difficultés de nos pays à décoller vers le développement, on a l’impression de vivre un éternel recommencement tel Sisyphe et son légendaire rocher.
Aller au-delà des analyses superficielles passe par une mise en examende ma propre science, le droit, pour voir s’il ne fait pas partie des coupables du retard économique depuis notre indépendance politique.
Concernant le Sénégal, après la gouvernance économique de Senghor, de Diouf et de Wade, nous vivons actuellement le PSE, un projet économique pour un programme politique ambitieux du parti de Sall actuellement au pouvoir… Je lui souhaite de réussir pour notre bien à tous !
Parmi les instruments ou les outils indispensables à cette réussite figure le DROIT. La question qui mérite donc d’être posée à ce niveau et que je pose ici, est celle de savoir si notre droit actuel, notre droit positif, assume le rôle de facilitateur de l’économie qu’on prétend lui faire jouer depuis la prise de conscience par la quasi-totalité des observateurs et acteurs du jeu économique africain de la nécessité d’un « droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté afin de faciliter l’activité des entreprises » pour paraphraser le Préambule du Traité pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Aujourd’hui, cette prise de conscience doit avoir comme objectif spécifique, la construction des fondements d’un véritable écosystème de la croissance et de l’innovation qui devra se traduire par un environnement juridique repensé.
Mais, avons-nous ici et maintenant, au Sénégal, un droit qui serait un outil au service d’une économie prête à affronter les défis du PSE, un droit pour la révolution numérique et ses innovations, un droit pour les exigences du monde rural d’aujourd’hui, un droit pour les enjeux technologiques de demain comme les bio et les nanotechnologies ou les neurosciences ?
Pour répondre, il faut sortir des sentiers battus comme je viens de le dire ci-dessus (je vais me répéter mais on dit que la répétition est pédagogique). Oui, les comportements des acteurs de la vie politique n’expliquent pas entièrement pourquoi nous sommes à la traîne dans les divers classements et autres modes d’évaluation des économies contemporaines. Permettez donc que je balaie devant ma propre porte. Que j’interroge ma discipline pour montrer comment elle impacte négativement sur notre économie, comment elle est au cœur de notre position économique actuelle et enfin, pourquoi il faudrait changer de paradigme dans le monde du droit pour en faire un véritable facilitateur de l’économie.
Oui. Il faut en effet savoir que le droit n’est pas une discipline abstraite ou désincarnée, mais plutôt le reflet d’un état d’esprit, d’une culture et de grands choix collectifs. Or le droit qui nous régit est frappé d’une tare originelle. C’est un droit emprunté, un droit venant essentiellement du droit français qui a certes fait école dans le monde à l’époque napoléonienne, mais dont les français eux-mêmes disent « qu’il tient du chef d’œuvre en péril : vieilli, anachronique, en déphasage complet avec le monde agile d’aujourd’hui. Pis, il condamne l’innovation, ce carburant d’une période de mutations intenses ». (Vincent Giret, Le droit, les rentiers ou l’innovation, Le Monde du 11 Mars 2016, p. 7)…Trois exemples pour illustrer ces propos…
Quel droit pour le numérique ?
En me limitant au mobile, on peut dire qu’on assiste aujourd’hui à une sorte d’inversion de paradigme dans les pratiques sociales incluant la technologie de pointe qu’est le téléphone portable. Des opérateurs innovants se sont engouffrés dans cette niche que constitue le marché des services financiers hors des guichets et des établissements bancaire proprement dits.Pour réglementer, la prise en compte de l’aspect convergence entre le droit bancaire et le droit des communications électroniques est une nécessité. Mais il y a une difficulté. Elle tient au fait que l’innovation ne provenant pas du tout des pays développés (ce sont les populations des pays en développement qui, par la pratique, imaginent des outils de contournement des difficultés d’accès aux services financiers relevant du monopole bancaire), on a du mal à implémenter une réglementation efficace. Oui, autant les pays développés fournissent généralement les modèles de réglementation pour les pays de l’ouest africain de tradition francophone par le biais de ces greffes que constituent les « legal transplants » ayant pour objet le transport du droit ou de règles d’un pays dans un autre, autant aujourd’hui, il y a lieu de faire jouer l’imagination car beaucoup de ces innovations n’entrent pas dans les casiers connus du droit positif.
Quel droit pour le monde rural ?
Le monde rural est la grande oubliée de l’OHADA. L’entreprise agricole, n’est toujours pas dotée de la structure juridique adéquate. En effet, dans un pays comme le Sénégal, malgré les nombreuses tentatives depuis les coopératives paysannes du temps du Président Senghor, jusqu’au groupement d’intérêt économique des années 80 sous le Président Abdou Diouf, en passant par les sociétés unipersonnelles ou plus récemment le statut de l’entreprenant du système OHADA, le monde rural n’arrive pas à trouver la structure idoine qui va le conduire aux formes d’exploitation économique qu’exige le monde contemporain.
Quel droit pour l’investissement dans les projets d’infrastructures ?
Toutes les formes d’investissements ne sont pas prises en compte dans le code des investissements. Notre code connait très bien l’investisseur économique traditionnel mais il ne s’est pas adapté aux mutations qui ont fait apparaître aussi bien l’investisseur professionnel, que l’investisseur dans les projets d’infrastructures. Le code des investissements est dépassé : l’investisseur du code existe toujours mais il s’installe dans des endroits très « compétitifs » comme les pays à régime autoritaire ou les pays à « faible intensité juridique » (très peu de protection pour les travailleurs et très peu de taxes et impôts).
L’investisseur professionnel, lui, est un investisseur au sens du droit des sociétés, c’est-à-dire concrètement, un actionnaire qui investit dans une grande société. Toutefois, ce n’est pas n’importe quel actionnaire, ni n’importe quel investisseur. On parle ici du gestionnaire de l’épargne collective ou fonds souverain appartenant à un Etat (gestionnaire de fonds de pension ou de fonds souverains étatiques). L’investisseur professionnel investit donc à la place de ses mandants (adhérents ou Etat) et pour leur compte, en prenant une participation minoritaire dans le capital de sociétés d’accueil.
L’arrivée de cet investisseur change absolument tout. Si on considère être en face d’un simple fournisseur de biens et services à l’administration, le droit des marchés publics aura vocation à s’appliquer. Mais s’il s’agit d’un investisseur qui vient « risquer ses billes », est-il toujours approprié de le mettre dans la procédure de la commande publique ? A mon avis, il y a quand même lieu de noter la différence entre une commande de l’administration et une proposition émanant d’un investisseur privé. Une inversion de ces données n’autorise-t-elle pas une autre structuration des relations Etat/secteur privé ?
En tout état de cause et quelle que soit la réponse, des mesures doivent être prévues dans le sens de la sauvegarde de notre souveraineté économique via nos entreprises locales. Une révision du code des investissements pourrait être envisagée pour déboucher sur une loi d’orientation de l’investissement au Sénégal avec comme objectif principal l’insertion du privé national dans notre tissu économique.
Pour conclure.
Ces trois exemples montrent que notre droit peine à faciliter la vie à l’activité économique.Les raisons sont à chercher dans le fait que le Nobel d’économie de 1993 Douglas North, appelle les « institutions », c’est-à-dire l’ensemble des lois, des règles écrites ou informelles ainsi que les instruments créés pour en contrôler leur bonne application, ces institutions donc ne sont pas en phase avec les besoins d’une économie dans la voie de l’émergence. Nous essayons de rattraper le retard avec les outils juridiques d’un autre âge. Oui, notre droit est resté statique et nous les juristes on continue à construire ce droit de manière autonome et abstraite en multipliant les typologies et les qualifications juridiques déconnectées des réalités économiques. C’est peut-être agréable et cohérent en soi, mais nos constructions sont davantage conçues pour les livres que pour la vie réelle. Au lieu de voir le droit comme un moyen, un outil, les juristes ont tendance à sacraliser le droit comme une valeur elle-même, comme une science qui se suffit à elle-même au lieu d’y voir un moyen par lequel divers acteurs peuvent réaliser des objectifs (Un droit pour l’innovation et la croissance, Vermeille, Kohmann et Luinaud, Fondation pour l’innovation politique, Paris, Février 2016).
Finalement, s’il n’est pas le seul coupable, on peut considérer que le droit pourrait être cité parmi les complices de notre indigence économique. En conséquence, il nous faut un autre droit pour accompagner notre développement économique…
Professeur Abdoulaye SAKHO
Institut EDGE/CRES
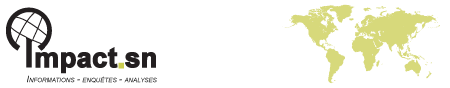
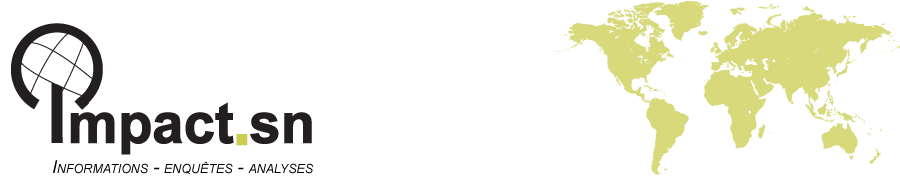
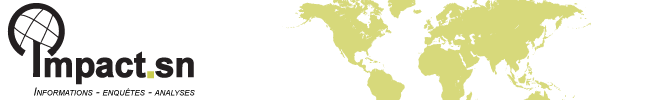





 PRÉSIDENTIELLE 2024
PRÉSIDENTIELLE 2024





 FRANCE
FRANCE









