L’économiste onusien devenu premier ministre du Soudan Abdallah Hamdok a jeté l’éponge dimanche, après avoir échoué dans son pari du consensus et du partenariat avec les généraux pour mener son pays à la démocratie après 30 ans de dictature.
En août 2019, il incarnait l’espoir d’une remise du pouvoir aux civils: il devait un temps partager la direction de ce grand pays d’Afrique de l’Est, l’un des plus pauvres au monde, avec l’armée quasiment toujours aux manettes depuis l’indépendance.
Ensuite, ce moustachu grisonnant de 65 ans rentré au Soudan dans la foulée de la «révolution» qui renversa en 2019 Omar el-Béchir aurait repris les rênes, entouré uniquement de civils pour organiser les premières élections libres après trois décennies de dictature militaro-islamiste.
Mais l’homme qui a fait carrière dans des organisations internationales et régionales, notamment comme secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU à Addis Abeba, a connu un premier revers de poids.
«Otage» puis «traître»
Le 25 octobre à l’aube, des soldats ont débarqué chez lui, l’emmenant avec son épouse chez le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l’armée qui annonçait peu après dissoudre toutes les institutions du pays et mettait de fait un point final à la transition démocratique.
La veille encore pourtant, les deux hommes rencontraient l’émissaire américain Jeffrey Feltman, plaidant tous deux pour une transition démocratique.
Un mois plus tard, le 21 novembre, le premier ministre, arrivé au pouvoir grâce au soutien des partisans d’un transfert complet du pouvoir aux civils, sortait de résidence surveillée et retrouvait son poste aux termes d’un accord avec le même général Burhan.
Au même moment il devenait pour la rue, qui longtemps avait réclamé la libération de son héros «otage», un «traître» qui, en s’alliant avec l’armée, facilitait de fait «le retour à l’ancien régime».
M. Hamdok, lui, plaidait la bonne foi, assurant vouloir faire «cesser l’effusion de sang» face à une répression ayant fait une cinquantaine de morts et sauvegarder «les acquis de la révolution» dans le pays qui amorce toujours son retour dans le concert des nations.
Mais le 19 décembre, pour le troisième anniversaire du lancement de la «révolution», il reconnaissait «un grand pas en arrière sur le chemin révolutionnaire», dénonçant violence et blocage politique.
Ce père de deux garçons qui a étudié l’économie agricole à Khartoum avant d’obtenir un master à Manchester, en Grande-Bretagne, a finalement annoncé dimanche sa démission, dans un discours télévisé à la nation.
«J’ai tenté de mon mieux d’empêcher le pays de glisser vers la catastrophe, alors qu’aujourd’hui il traverse un tournant dangereux qui menace sa survie (…) au vu des conflits entre les composantes (civile et militaire) de la transition (…) Malgré tout ce qui a été fait pour parvenir à un consensus (…) cela ne s’est pas produit», a-t-il notamment argué.
Lui qui, grâce aux gages donnés aux bailleurs internationaux, avait obtenu un allègement considérable de la dette nationale et une levée des sanctions américaines, ne voulait plus jouer le rôle de visage civil d’un coup d’État militaire qui a réveillé le spectre d’un isolement international.
Paix et bonne gouvernance
Outre les acquis économiques, parmi les faits d’armes de M. Hamdok, né au Kordofan-Sud le 1er janvier 1956, figure la conclusion d’un accord de paix en octobre 2020 avec une coalition de groupes rebelles. Comme le Darfour et le Nil Bleu, le Kordofan-Sud a été pendant plusieurs années le théâtre d’un conflit entre rebelles et forces gouvernementales.
Lui qui jouissait à sa nomination d’une image de champion de la transparence et de la bonne gouvernance, notamment pour avoir refusé en 2018 le ministère des Finances que Béchir lui proposait, n’est toutefois pas parvenu à doter le pays d’institutions démocratiques – dont un Parlement qui attend toujours d’être formé.
Souriant à sa prise de pouvoir, il promettait aux 45 millions de Soudanais de promouvoir «la bonne vision et les bonnes politiques (pour) affronter la crise économique».
Mais dans un pays où les infrastructures essentielles manquent, la rigueur économique n’a fait qu’accroître le mécontentement d’une population appauvrie par une inflation à plus de 300%.
En outre, face à des militaires tout-puissants, son gouvernement n’est jamais parvenu à obtenir justice pour les proches des plus de 250 morts de la répression de la «révolution» de 2019. Depuis le coup d’État du 25 octobre, 56 nouveaux morts sont venus s’ajouter à cette longue liste de familles endeuillées. (AFP)
En août 2019, il incarnait l’espoir d’une remise du pouvoir aux civils: il devait un temps partager la direction de ce grand pays d’Afrique de l’Est, l’un des plus pauvres au monde, avec l’armée quasiment toujours aux manettes depuis l’indépendance.
Ensuite, ce moustachu grisonnant de 65 ans rentré au Soudan dans la foulée de la «révolution» qui renversa en 2019 Omar el-Béchir aurait repris les rênes, entouré uniquement de civils pour organiser les premières élections libres après trois décennies de dictature militaro-islamiste.
Mais l’homme qui a fait carrière dans des organisations internationales et régionales, notamment comme secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU à Addis Abeba, a connu un premier revers de poids.
«Otage» puis «traître»
Le 25 octobre à l’aube, des soldats ont débarqué chez lui, l’emmenant avec son épouse chez le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l’armée qui annonçait peu après dissoudre toutes les institutions du pays et mettait de fait un point final à la transition démocratique.
La veille encore pourtant, les deux hommes rencontraient l’émissaire américain Jeffrey Feltman, plaidant tous deux pour une transition démocratique.
Un mois plus tard, le 21 novembre, le premier ministre, arrivé au pouvoir grâce au soutien des partisans d’un transfert complet du pouvoir aux civils, sortait de résidence surveillée et retrouvait son poste aux termes d’un accord avec le même général Burhan.
Au même moment il devenait pour la rue, qui longtemps avait réclamé la libération de son héros «otage», un «traître» qui, en s’alliant avec l’armée, facilitait de fait «le retour à l’ancien régime».
M. Hamdok, lui, plaidait la bonne foi, assurant vouloir faire «cesser l’effusion de sang» face à une répression ayant fait une cinquantaine de morts et sauvegarder «les acquis de la révolution» dans le pays qui amorce toujours son retour dans le concert des nations.
Mais le 19 décembre, pour le troisième anniversaire du lancement de la «révolution», il reconnaissait «un grand pas en arrière sur le chemin révolutionnaire», dénonçant violence et blocage politique.
Ce père de deux garçons qui a étudié l’économie agricole à Khartoum avant d’obtenir un master à Manchester, en Grande-Bretagne, a finalement annoncé dimanche sa démission, dans un discours télévisé à la nation.
«J’ai tenté de mon mieux d’empêcher le pays de glisser vers la catastrophe, alors qu’aujourd’hui il traverse un tournant dangereux qui menace sa survie (…) au vu des conflits entre les composantes (civile et militaire) de la transition (…) Malgré tout ce qui a été fait pour parvenir à un consensus (…) cela ne s’est pas produit», a-t-il notamment argué.
Lui qui, grâce aux gages donnés aux bailleurs internationaux, avait obtenu un allègement considérable de la dette nationale et une levée des sanctions américaines, ne voulait plus jouer le rôle de visage civil d’un coup d’État militaire qui a réveillé le spectre d’un isolement international.
Paix et bonne gouvernance
Outre les acquis économiques, parmi les faits d’armes de M. Hamdok, né au Kordofan-Sud le 1er janvier 1956, figure la conclusion d’un accord de paix en octobre 2020 avec une coalition de groupes rebelles. Comme le Darfour et le Nil Bleu, le Kordofan-Sud a été pendant plusieurs années le théâtre d’un conflit entre rebelles et forces gouvernementales.
Lui qui jouissait à sa nomination d’une image de champion de la transparence et de la bonne gouvernance, notamment pour avoir refusé en 2018 le ministère des Finances que Béchir lui proposait, n’est toutefois pas parvenu à doter le pays d’institutions démocratiques – dont un Parlement qui attend toujours d’être formé.
Souriant à sa prise de pouvoir, il promettait aux 45 millions de Soudanais de promouvoir «la bonne vision et les bonnes politiques (pour) affronter la crise économique».
Mais dans un pays où les infrastructures essentielles manquent, la rigueur économique n’a fait qu’accroître le mécontentement d’une population appauvrie par une inflation à plus de 300%.
En outre, face à des militaires tout-puissants, son gouvernement n’est jamais parvenu à obtenir justice pour les proches des plus de 250 morts de la répression de la «révolution» de 2019. Depuis le coup d’État du 25 octobre, 56 nouveaux morts sont venus s’ajouter à cette longue liste de familles endeuillées. (AFP)
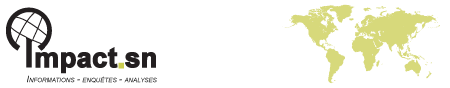
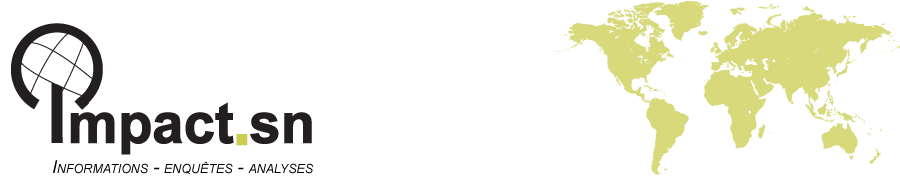
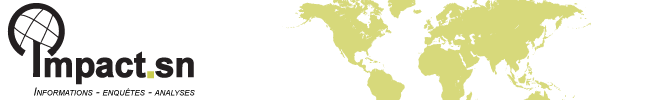






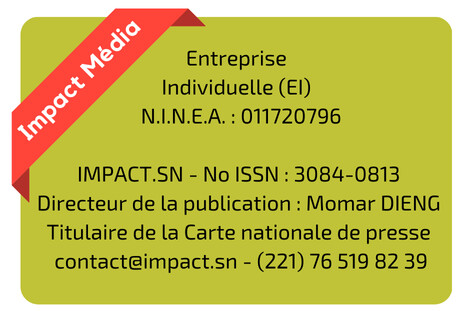





 FRANCE
FRANCE









