
Et au-delà du simple discours incantatoire, David Diop est, comme qui dirait, passé à l’acte à un moment important des relations exécrables que la métropole a entretenues avec certains de ses colonies dont la Guinée d’Ahmed Sékou Touré. A Alioune Diop, fondateur de Présence africaine il écrivait par exemple cette lettre :
«Mon cher Alioune, (…) je pars pour la Guinée au début de la semaine prochaine en compagnie de Abdou Moumouni, de Joseph Ki-Zerbo et quatre autres professeurs africains. Comme je l’ai écrit, il est des cas om celui qui se prend intellectuel ne doit plus se contenter de vœux pieux et de déclaration d’intention mais donner à ses écrits un prolongement concret. Seule, une question de famille m’a fait hésiter quelque temps ; mais après mûre réflexion, ce problème ne m’a pas paru être un obstacle à mon départ.»
Considéré comme le principal représentant de la «poésie protestataire», David Diop écrit dans «Bois d’ébène» : «Afrique j’ai gardé ta mémoire – Tu es en moi – Comme l’écharde dans la blessure – Comme un fétiche tutélaire au centre du village – Fais de moi la pierre de ta fronde – De ma bouche les lèvres de ta plaie – De mes genoux les colonnes brisées de ton abaissement.»
Avec une virulence positionnée sur la ligne d’Aimé Césaire, loin des compromis de Senghor dont il a été l’élève, le poète né à Bordeaux d’un père sénégalais et d’une mère camerounaise fut un adversaire impénitent de la soumission et de l’abandon. «Toi mon frère au visage de peur et d’angoisse – Relève-toi et crie : Non !» (in «Défi à la force»)
KEN BUGUL ALIAS MARIETOU MBAYE
L’afroptimiste de cœur et d’esprit
Quand on devient «Grand prix littéraire de l’Afrique noire» (Riwan où le chemin du sable, 1999), on n’est pas n’importe qui. Ken Bugul, romancière sénégalaise aujourd’hui âgée de 69 ans, n’est pas n’importe qui, même si la traduction française de son nom d’artiste renvoie à «celle dont personne ne veut», un paria que l’on tolère en désespoir de cause et que l’on jette dans le panier des mille et une superstitions qui infestent le tissu traditionnel africain.
Cette femme n’a pourtant rien d’un paria dans le monde littéraire africain et mondial où son engagement en faveur de l’émancipation et de la liberté des femmes africaines est total, encadré par un vrai talent et une détermination quasi mystique. Dans un entretien au magazine en ligne «Africultures», celle qui est Mariétou Mbaye à l’état-civil s’insurge contre les barrières que certaines traditions en vogue sur le continent opposent à ses «sœurs».
Alors, pourquoi n’écrit-elle pas en wolof ou dans une autre langue locale, par exemple, pour toucher le maximum d’entre elles ? «(…) C’est parce que le vocabulaire était limité pour les filles. Dans mon éducation, à l’époque, je ne pouvais pas exprimer la colère, ou bien des gros mots en wolof. Quand je suis fâchée, encore aujourd’hui, je m’exprime en français ou en anglais (à cause d’)«un vocabulaire pour la femme limitée…» La faute à une «hiérarchie sociale», possiblement incarnée par la «tante paternelle», qui laisse à d’autres le soin de parler pour les femmes et au nom des femmes. «Le ‘je’ traditionnellement n’existe pas, c’est le ‘nous’ (…) qui compte. Le ‘je’ est déjà une transgression.»
La trilogie de son œuvre romanesque, «Le Baobab fou» (1982), «Cendres et braises» (1994) et «Riwan où le chemin de sable» (1999) est l’expression d’une autobiographie qui fait s’emmêler diverses problématiques : les rapports à la tradition, l’exil vu sous le prisme des angoisses et humiliations qui en découlent, le déracinement issu de l’école française, et son pendant, l’acculturation, les espoirs et difficultés d’un retour au pays natal, etc.
Sa fibre africaniste, Ken Bugul la met en œuvre dans «La folie et la mort» comme une sorte de plaidoyer pour un continent aux confins de toutes les tragédies : pouvoirs autoritaires, pauvreté permanente, guerres sans fin, dépendance structurelle à l’égard de l’Occident, etc. Un tableau ultra-sombre qui ne la range pas pour autant dans le cercle si débridé des intellectuels afro-pessimistes. C’est une optimiste indécrottable. «Si l’Afrique survit malgré tous les ‘malgré’, c’est grâce à la puissance de l’imagination parce qu’on utilise tous les jours notre imagination pour nous en sortir. Dès qu’on réveille le matin, on se demande ce qu’on peut manger, la santé, la nourriture, pour les enfants... Tout de suite, on cherche des solutions. Il n’y a pas de problèmes en Afrique, il n’y a que des solutions. C’est pour ça que c’est dynamique, énergique et j’adore ça. Dans les pays développés, je m’ennuie.»
Ecrivaine engagée, Ken Bugul fait partie de ceux qui «avancent sans se retourner», celle qui refuse d’être l’esclave du doute et de l’incertitude. Ce n’est pas elle qui demandera «réparation» aux anciennes métropoles qui, avec plusieurs siècles de colonisation, ont fait de l’Afrique un continent mal parti.
«Mon cher Alioune, (…) je pars pour la Guinée au début de la semaine prochaine en compagnie de Abdou Moumouni, de Joseph Ki-Zerbo et quatre autres professeurs africains. Comme je l’ai écrit, il est des cas om celui qui se prend intellectuel ne doit plus se contenter de vœux pieux et de déclaration d’intention mais donner à ses écrits un prolongement concret. Seule, une question de famille m’a fait hésiter quelque temps ; mais après mûre réflexion, ce problème ne m’a pas paru être un obstacle à mon départ.»
Considéré comme le principal représentant de la «poésie protestataire», David Diop écrit dans «Bois d’ébène» : «Afrique j’ai gardé ta mémoire – Tu es en moi – Comme l’écharde dans la blessure – Comme un fétiche tutélaire au centre du village – Fais de moi la pierre de ta fronde – De ma bouche les lèvres de ta plaie – De mes genoux les colonnes brisées de ton abaissement.»
Avec une virulence positionnée sur la ligne d’Aimé Césaire, loin des compromis de Senghor dont il a été l’élève, le poète né à Bordeaux d’un père sénégalais et d’une mère camerounaise fut un adversaire impénitent de la soumission et de l’abandon. «Toi mon frère au visage de peur et d’angoisse – Relève-toi et crie : Non !» (in «Défi à la force»)
KEN BUGUL ALIAS MARIETOU MBAYE
L’afroptimiste de cœur et d’esprit
Quand on devient «Grand prix littéraire de l’Afrique noire» (Riwan où le chemin du sable, 1999), on n’est pas n’importe qui. Ken Bugul, romancière sénégalaise aujourd’hui âgée de 69 ans, n’est pas n’importe qui, même si la traduction française de son nom d’artiste renvoie à «celle dont personne ne veut», un paria que l’on tolère en désespoir de cause et que l’on jette dans le panier des mille et une superstitions qui infestent le tissu traditionnel africain.
Cette femme n’a pourtant rien d’un paria dans le monde littéraire africain et mondial où son engagement en faveur de l’émancipation et de la liberté des femmes africaines est total, encadré par un vrai talent et une détermination quasi mystique. Dans un entretien au magazine en ligne «Africultures», celle qui est Mariétou Mbaye à l’état-civil s’insurge contre les barrières que certaines traditions en vogue sur le continent opposent à ses «sœurs».
Alors, pourquoi n’écrit-elle pas en wolof ou dans une autre langue locale, par exemple, pour toucher le maximum d’entre elles ? «(…) C’est parce que le vocabulaire était limité pour les filles. Dans mon éducation, à l’époque, je ne pouvais pas exprimer la colère, ou bien des gros mots en wolof. Quand je suis fâchée, encore aujourd’hui, je m’exprime en français ou en anglais (à cause d’)«un vocabulaire pour la femme limitée…» La faute à une «hiérarchie sociale», possiblement incarnée par la «tante paternelle», qui laisse à d’autres le soin de parler pour les femmes et au nom des femmes. «Le ‘je’ traditionnellement n’existe pas, c’est le ‘nous’ (…) qui compte. Le ‘je’ est déjà une transgression.»
La trilogie de son œuvre romanesque, «Le Baobab fou» (1982), «Cendres et braises» (1994) et «Riwan où le chemin de sable» (1999) est l’expression d’une autobiographie qui fait s’emmêler diverses problématiques : les rapports à la tradition, l’exil vu sous le prisme des angoisses et humiliations qui en découlent, le déracinement issu de l’école française, et son pendant, l’acculturation, les espoirs et difficultés d’un retour au pays natal, etc.
Sa fibre africaniste, Ken Bugul la met en œuvre dans «La folie et la mort» comme une sorte de plaidoyer pour un continent aux confins de toutes les tragédies : pouvoirs autoritaires, pauvreté permanente, guerres sans fin, dépendance structurelle à l’égard de l’Occident, etc. Un tableau ultra-sombre qui ne la range pas pour autant dans le cercle si débridé des intellectuels afro-pessimistes. C’est une optimiste indécrottable. «Si l’Afrique survit malgré tous les ‘malgré’, c’est grâce à la puissance de l’imagination parce qu’on utilise tous les jours notre imagination pour nous en sortir. Dès qu’on réveille le matin, on se demande ce qu’on peut manger, la santé, la nourriture, pour les enfants... Tout de suite, on cherche des solutions. Il n’y a pas de problèmes en Afrique, il n’y a que des solutions. C’est pour ça que c’est dynamique, énergique et j’adore ça. Dans les pays développés, je m’ennuie.»
Ecrivaine engagée, Ken Bugul fait partie de ceux qui «avancent sans se retourner», celle qui refuse d’être l’esclave du doute et de l’incertitude. Ce n’est pas elle qui demandera «réparation» aux anciennes métropoles qui, avec plusieurs siècles de colonisation, ont fait de l’Afrique un continent mal parti.
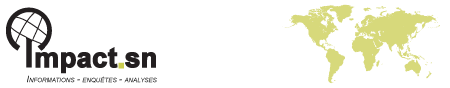
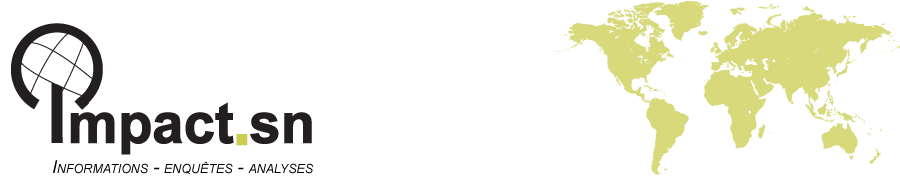
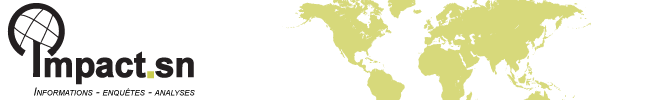





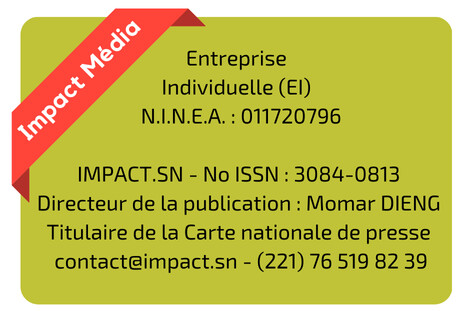





 FRANCE
FRANCE















