Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson s'est longuement entretenu jeudi soir à Ankara avec le président turc Recep Tayyip Erdogan pour tenter d'apaiser des relations rendues explosives par l'offensive turque en Syrie contre une milice kurde alliée de Washington.
Selon des responsables turcs, le chef de l'Etat a "transmis de façon claire" au secrétaire d'Etat toutes "les attentes de la Turquie" sur la Syrie, l'Irak, mais aussi sur la longue liste de contentieux qui empoisonnent les relations entre leurs deux pays pourtant alliés au sein de l'Otan.
Un porte-parole du département d'Etat américain s'est borné à évoquer une "conversation fructueuse et ouverte pour permettre d'avancer de manière bénéfique aux deux pays". Il a espéré de "nouveaux progrès" lors de la rencontre de vendredi entre Rex Tillerson et son homologue turc Mevlüt Cavusoglu.
Le chef de la diplomatie américaine n'a en revanche pas fait de déclarations. "Pas ce soir, nous avons encore du travail", a-t-il seulement répondu à des journalistes qui l'interrogeaient sur cet entretien de près de 3H30 auquel l'unique autre participant était Mevlüt Cavusoglu, qui a également joué l'interprète.
"Nos relations sont à un moment très critique. Soit nous améliorons nos relations, soit elles vont s'effondrer complètement", avait mis en garde ce dernier avant la visite.
"La discussion s'annonce difficile", reconnaissait-on à Washington, où l'on souligne que la "rhétorique turque" est "très enflammée".
Symbole de cette mauvaise passe: la capitale turque a décidé de rebaptiser une avenue longeant l'ambassade des Etats-Unis "Rameau d'olivier", du nom de l'opération militaire turque déclenchée le 20 janvier dans le nord de la Syrie.
Or, c'est cette offensive contre l'enclave d'Afrine et les Unités de protection du peuple (YPG) qui envenime plus que jamais la situation. Ankara considère cette milice kurde comme "terroriste", mais il s'agit aussi d'un allié-clé des Etats-Unis dans la lutte contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI).
Après les appels à la "retenue", Rex Tillerson a protesté mardi contre une opération qui "détourne" les forces antijihadistes de leur combat prioritaire, estimant que des éléments kurdes ont déjà quitté l'est syrien pour prêter main forte aux YPG à Afrine.
- 'N'aggravons pas les choses' -
"La situation est assez compliquée comme ça, n'aggravons pas les choses", a dit un membre de la délégation de Rex Tillerson.
Le ministre turc de la Défense Nurettin Canikli, qui a lui rencontré à Bruxelles son homologue américain Jim Mattis, a dit avoir "demandé la fin de tout type de soutien aux YPG, et le retrait de cette structure des FDS", une coalition arabo-kurde dominée par cette milice.
"M. Mattis a indiqué qu'ils allaient fournir un soutien plus actif, plus concret et net", a-t-il ajouté, notamment en partageant des renseignement dans la lutte menée en Irak contre les séparatistes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), bête noire d'Ankara.
La situation pourrait s'aggraver si la Turquie avance comme promis vers Minbej, à une centaine de kilomètres à l'est d'Afrine, également contrôlée par les YPG mais avec des militaires américains à leur côté -- le président Erdogan a menacé les Américains de leur infliger une "claque ottomane".
"Nous allons à Minbej, et s'ils sont là, tant pis pour eux", lâche un haut responsable turc à l'AFP. "Nous n'avons pas besoin de leurs recommandations, mais de mesures concrètes sur le terrain."
Sur ce sujet, les échanges risquaient de virer au dialogue de sourds.
Les Américains entendaient discuter des "mesures qui peuvent être prises" face aux "inquiétudes sécuritaires légitimes" des Turcs. Mais Ankara exige que Washington rompe avec les YPG et reprenne les armes fournies à cette milice.
"Nous n'avons jamais donné d'armes lourdes aux YPG, donc il n'y en a aucune à reprendre", a rétorqué jeudi M. Tillerson à Beyrouth, juste avant d'arriver à Ankara. Il avait auparavant prévenu que les Etats-Unis allaient "continuer à former des forces de sécurité locales", tout en veillant à ce qu'elles "ne représentent pas une menace" pour les "voisins".
"Le simple déplacement du secrétaire d'Etat démontre que nous considérons qu'il s'agit malgré tout d'une relation qui nous permet de se parler ouvertement", nuance le membre de la délégation américaine. Et Jim Mattis a estimé à Bruxelles qu'un "terrain d'entente" était possible.
La crise syrienne vient s'ajouter à une longue liste de différends, notamment depuis le putsch raté de 2016 en Turquie. Washington n'a pas donné suite aux demandes d'extradition du prédicateur Fethullah Gülen, désigné par Ankara comme le cerveau de la tentative de coup d'Etat et installé aux Etats-Unis.
Et l'arrestation d'au moins deux employés turcs des missions diplomatiques américaines en Turquie a récemment déclenché une crise des visas, dont le gel réciproque n'a pris fin qu'en décembre.
Les Etats-Unis dénoncent aussi l'incarcération de plusieurs Américains, dont Serkan Gölge, un scientifique de la Nasa condamné la semaine dernière à sept ans et demi de prison pour appartenance aux réseaux Gülen.
"L'antiaméricanisme marche bien en Turquie", constate Max Hoffman, du Center for American Progress. Pour lui, le président Erdogan "a choisi d'attiser la colère de l'opinion pour marquer des points politiques".
Selon des responsables turcs, le chef de l'Etat a "transmis de façon claire" au secrétaire d'Etat toutes "les attentes de la Turquie" sur la Syrie, l'Irak, mais aussi sur la longue liste de contentieux qui empoisonnent les relations entre leurs deux pays pourtant alliés au sein de l'Otan.
Un porte-parole du département d'Etat américain s'est borné à évoquer une "conversation fructueuse et ouverte pour permettre d'avancer de manière bénéfique aux deux pays". Il a espéré de "nouveaux progrès" lors de la rencontre de vendredi entre Rex Tillerson et son homologue turc Mevlüt Cavusoglu.
Le chef de la diplomatie américaine n'a en revanche pas fait de déclarations. "Pas ce soir, nous avons encore du travail", a-t-il seulement répondu à des journalistes qui l'interrogeaient sur cet entretien de près de 3H30 auquel l'unique autre participant était Mevlüt Cavusoglu, qui a également joué l'interprète.
"Nos relations sont à un moment très critique. Soit nous améliorons nos relations, soit elles vont s'effondrer complètement", avait mis en garde ce dernier avant la visite.
"La discussion s'annonce difficile", reconnaissait-on à Washington, où l'on souligne que la "rhétorique turque" est "très enflammée".
Symbole de cette mauvaise passe: la capitale turque a décidé de rebaptiser une avenue longeant l'ambassade des Etats-Unis "Rameau d'olivier", du nom de l'opération militaire turque déclenchée le 20 janvier dans le nord de la Syrie.
Or, c'est cette offensive contre l'enclave d'Afrine et les Unités de protection du peuple (YPG) qui envenime plus que jamais la situation. Ankara considère cette milice kurde comme "terroriste", mais il s'agit aussi d'un allié-clé des Etats-Unis dans la lutte contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI).
Après les appels à la "retenue", Rex Tillerson a protesté mardi contre une opération qui "détourne" les forces antijihadistes de leur combat prioritaire, estimant que des éléments kurdes ont déjà quitté l'est syrien pour prêter main forte aux YPG à Afrine.
- 'N'aggravons pas les choses' -
"La situation est assez compliquée comme ça, n'aggravons pas les choses", a dit un membre de la délégation de Rex Tillerson.
Le ministre turc de la Défense Nurettin Canikli, qui a lui rencontré à Bruxelles son homologue américain Jim Mattis, a dit avoir "demandé la fin de tout type de soutien aux YPG, et le retrait de cette structure des FDS", une coalition arabo-kurde dominée par cette milice.
"M. Mattis a indiqué qu'ils allaient fournir un soutien plus actif, plus concret et net", a-t-il ajouté, notamment en partageant des renseignement dans la lutte menée en Irak contre les séparatistes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), bête noire d'Ankara.
La situation pourrait s'aggraver si la Turquie avance comme promis vers Minbej, à une centaine de kilomètres à l'est d'Afrine, également contrôlée par les YPG mais avec des militaires américains à leur côté -- le président Erdogan a menacé les Américains de leur infliger une "claque ottomane".
"Nous allons à Minbej, et s'ils sont là, tant pis pour eux", lâche un haut responsable turc à l'AFP. "Nous n'avons pas besoin de leurs recommandations, mais de mesures concrètes sur le terrain."
Sur ce sujet, les échanges risquaient de virer au dialogue de sourds.
Les Américains entendaient discuter des "mesures qui peuvent être prises" face aux "inquiétudes sécuritaires légitimes" des Turcs. Mais Ankara exige que Washington rompe avec les YPG et reprenne les armes fournies à cette milice.
"Nous n'avons jamais donné d'armes lourdes aux YPG, donc il n'y en a aucune à reprendre", a rétorqué jeudi M. Tillerson à Beyrouth, juste avant d'arriver à Ankara. Il avait auparavant prévenu que les Etats-Unis allaient "continuer à former des forces de sécurité locales", tout en veillant à ce qu'elles "ne représentent pas une menace" pour les "voisins".
"Le simple déplacement du secrétaire d'Etat démontre que nous considérons qu'il s'agit malgré tout d'une relation qui nous permet de se parler ouvertement", nuance le membre de la délégation américaine. Et Jim Mattis a estimé à Bruxelles qu'un "terrain d'entente" était possible.
La crise syrienne vient s'ajouter à une longue liste de différends, notamment depuis le putsch raté de 2016 en Turquie. Washington n'a pas donné suite aux demandes d'extradition du prédicateur Fethullah Gülen, désigné par Ankara comme le cerveau de la tentative de coup d'Etat et installé aux Etats-Unis.
Et l'arrestation d'au moins deux employés turcs des missions diplomatiques américaines en Turquie a récemment déclenché une crise des visas, dont le gel réciproque n'a pris fin qu'en décembre.
Les Etats-Unis dénoncent aussi l'incarcération de plusieurs Américains, dont Serkan Gölge, un scientifique de la Nasa condamné la semaine dernière à sept ans et demi de prison pour appartenance aux réseaux Gülen.
"L'antiaméricanisme marche bien en Turquie", constate Max Hoffman, du Center for American Progress. Pour lui, le président Erdogan "a choisi d'attiser la colère de l'opinion pour marquer des points politiques".
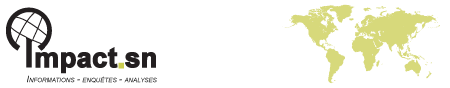
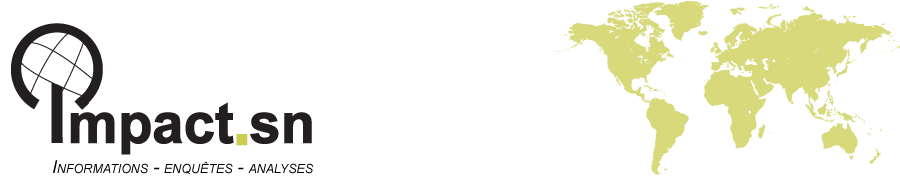
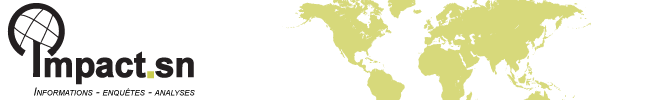






 PRÉSIDENTIELLE 2024
PRÉSIDENTIELLE 2024





 FRANCE
FRANCE











